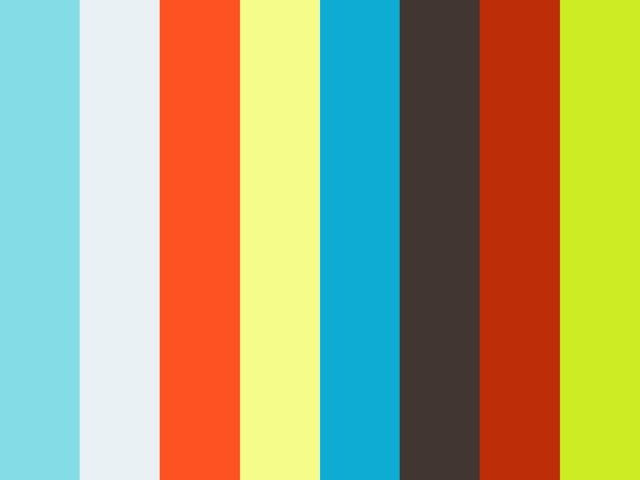Abbé Léon Vouaux - 2me Partie
Les Semaines de Guerre
----
L'ACCEPTATION DU SACRIFICE
On était à la dernière semaine de juillet 1914. Les bruits de guerre s'accentuaient à Nancy : et l'abbé Léon Vouaux en avait averti son frère. Le jeudi 30, il reçut lui-même à la Malgrange une lettre qui lui demandait de venir promptement à Jarny (a) pour y remplacer, le cas échéant curé et vicaires mobilisés. Personnellement il préférait s’offrir à l'autorité militaire comme aumônier. Quelle décision prendre? De part et d'autre le danger existait. Mais ce n'était pas le péril qui faisait hésiter cette âme si simplement héroïque.
(a). Jarny est l'une de ces localités, autrefois agricoles maintenant industrielles, qu'a développées l'exploitation du minerai de fer dans le bassin de Briey. Déjà citée dans un document du Xme siècle, elle compte environ 700 habitants en 1907, 4500 en 1914, 7000 en 1928 (dont plus de 2000 étrangers). Elle est à dix kilomètres de l'ancienne frontière, sur une des deux routes de Metz à Verdun.
Un de ses, collègues, M. l'abbé CH., a suivi de près les principales phases de ses réflexions.
<< Qu'irai-je faire là-bas? Y serai-je utile? Si près de le frontière, je serai pris tout de suite, emmené prisonnier, au moins ... En contact avec ses sales Prussiens, pourrai-je me contenir?...Mieux vaut m'engager!>>
Ainsi s'exprime à plusieurs reprises l"abbé Léon Vouaux. << Et cette insistance>>, remarque M. l'abbé CH., <<me fit prévoir une décision en sens contraire>>.
De fait, une heure plus tard les deux professeurs s'entrevirent encore, le premier, sacoche au dos, en tenue de voyage.
<< Après tout, je pars! Je connais l'allemand : je pourrais peut-être rendre service aux paroissiens de mon frère. D'autre part, ça lui fera plaisir. J'y vais!... Qu'est-ce qui m'arrivera?.. Je crois que c'est mon devoir. Oui, je pars!>>
<< Il m'a semblé qu'il avait le pressentiment très net des dangers qui l'attendaient >>, conclut M. CH.
Tous deux échangèrent une dernière poignée de main et se quittèrent. L'abbé Léon Vouaux ne devait plus entrer à la Malgrange.
Le 30 juillet au soir, il arrivait à Jarny.
Les deux frères auraient eu 48 heures pour échanger leurs recommandations personnelles, leurs impressions au sujet de la paroisse et du pays, si l'effervescence générale ne s'était répercutée au presbytère et à l'église.
Parmi les Jarnisiens que touchaient les ordres d'appel individuel, parmi les chasseurs à pied qui gardaient les routes à la frontière, il en était qui voulurent régler leurs affaires de conscience avant d'affronter la mort. D'autres personnes quêtaient les paroles rassurantes ou consolatrices. Des familles oublieuses se hâtaient de réparer le retard du baptême des enfants. Sur le registre spécial les signatures du curé, du vicaire, du professeur, alternent le 1er août. Mais du 2 au 23, pour onze actes on ne voit plus que la fine écriture et le sobre paraphe du <<prêtre délégué, Léon Vouaux>>.
La délégation s'était transmise sans protocole. << Tu feras tout ce que je ferais. - Oui, sois tranquille.>>
L'entente avec le maire, M Henri Génot, fut aussi concise. << ...Mon frère est obligé de quitter Jarny. Mais vous pouvez compter sur moi comme vous comptiez sur lui. Je suis prêt à tout pour vous aider dans votre tâche.>>
Ce fut dans la mairie, où M. Génot signait sans trêve les laissez-passer de quantité d'Italiens, que se convint cette entente, bientôt scellée dans le sang.
Quelques instants après, le curé de Jarny, M. l'abbé Auguste Vouaux, et son vicaire M. l'abbé Veiber, prenaient place dans cet exode qui, sur le route de Verdun, entremêlait mobilisés, familles encombrées de paquets, voitures et troupeaux réquisitionnés, pitoyable défilé, que du moins n'affolaient pas encore des crimes barbares.
La séparation était acceptée. << Si nous ne nous retrouvons plus en ce monde, nous nous reverrons Là-Haut!>> Une dernière fois celui qui partait se retourna et vit son frère, qui face à Jarny, s'essuyait les yeux... C'était à quelques mètres de l'endroit où, vingt cinq jours plus tard , sans larmes, tomba la victime volontaire.
Le 1er août au soir, l'abbé Léon Vouaux restait seul prêtre dans la paroisse.
L'attente du sacrifice
----
LA PREMIERE SEMAINE
Les premiers temps de la guerre ne furent marqués à Jarny par aucun fait saillant. La localité était devenue comme une zone neutre, où tour à tour apparaissent les patrouilles françaises et allemandes
<< M. l'abbé Léon Vouaux avait obtenu très facilement de nos officiers un laissez-passer général; et il en profitait pour parcourir, comme son frère, l'immense paroisse de Jarny. Il était devenu un curé parfait, continuellement en rapports intimes, affectueux et prévenants avec tous les paroissiens qu'il rencontrait dans ses courses ou qui venaient lui demander conseil.>> (Lettre d'un témoin).
Il refoulait ainsi ses préoccupations personnelles, car il ne se faisait guère illusion. En voici seulement deux preuves, propres à révéler son état d'âme.
Le 4 août il était allé voir le curé de Labry, son ancien confrère au collège de la Malgrange. Entendant sauter un des ponts de la gare et craignant aussi la destruction du pont sur l'Orne, il quitta M. Perrin en lui disant : << Il faut partir avant qu'il y ait du danger.... Et puis après tout ..., une balle!...une balle!...>>.
Non, il ne la redoutait pas, lui qui, peu de temps avant la guerre, peut-être contrarié de ne pouvoir travailler selon ses goûts, peut-être même ayant peur d'être obligé à l'inaction sur ses vieux jours, disait familièrement à l'un de ses collègues : << Moi, je désirerais mourir d'une balle! >>
Le samedi 8 août, à 6 heures du soir, il écrivit la seule grande lettre qui soit parvenue à son frère. Elle est trop caractéristique pour qu'elle ne soit pas transcrite presque entière :
<< On me dit qu'un courrier va partir pour Etain : je me hâte d'en profiter, à tout hasard.
<< La paroisse n'a jamais été aussi pieuse que dans ces derniers jours; et j'ai dû faire une dizaine de baptêmes. Cela t'indique du reste que la pays n'a pas encore été occupé. Il y a eu des escarmouches entre patrouilles françaises et allemandes, avec tués et blessés des deux côtés. Malheureusement, c'est chez nous que les pertes, aux environs, sont jusqu'ici les plus fortes. Les chasseurs à cheval font admirablement leur service; mais ils ont perdu trois hommes; l'un d'eux est en ce moment à la mairie et on l'enterre ce soir ou demain. Mais cela n'est rien à côté de ce qui s'est passé pour les chasseurs à pied...
<< Comme on prie bien, mon cher, en ces circonstances, pour tant de jeunes gens et pour la France entière! Il est impossible du reste de s'appliquer à un travail soutenu. Je suis agacé parfois de voir des femmes, désœuvrées, négligeant leur ménage, arpenter constamment les rues; mais je suis bien obligé de les excuser quand je réfléchis à mon propre état. C'est une privation incroyablement pénible que de rester ainsi sans nouvelles de toi (1), sans nouvelles générales, et d'entendre se répandre les bruits les plus invraisemblables, et, il faut bien l'ajouter, les plus énervants. Je pourrai dire que j'ai fait ici, à défaut d'autre étude, celle du cœur humain, que je ne soupçonnais pas si prompt à s'émouvoir, à s'enthousiasmer ou à s'abattre, et celle de l'imagination populaire, dont aucune réflexion n'arrête les élans. Il faut pardonner bien aveuglement à des esprits si peu raisonnables.
(1) Il renouvelle cette plainte dans les quelques lignes des deux cartes qui constituent, avec la lettre, toute sa correspondance reçue de Jarny. On comprend sa peine fraternelle en pesant une des dernières paroles à M. le Curé de Labry :<< Je n'ai plus que mon frère, je n'ai plus que lui!>>... Et quelle révélation pour ceux qui l'auraient méconnu, que la suprême salutation de sa lettre!
<< Te parlerai-je maintenant de moi-même? Je vais très bien : que cela te suffise; et je me suis habitué à mon rôle, tout en redoutant, pour sa responsabilité, celui qui se prépare pendant l'occupation du village.
<< Ce qui m'étonne, c'est que celle-ci ne soit pas effectuée encore. Le plus grand nombre des patrouilles allemandes se rencontrent plutôt au nord de Conflans, dans les bois d'Abbéville en particulier. Il semble qu'il n'y ait de la part de l'ennemi que l'intention de masquer, par un faible rideau de troupes, un mouvement important vers le nord. C'est ce que confirme ce que nous apprenons de l'attaque contre la Belgique.
<< Mon bien cher Auguste, je t'embrasse bien tendrement, en plaçant notre affection sous la protection de Notre-Seigneur. >>
LA DEUXIEME SEMAINE
La première victime militaire inhumée à Jarny, est le brigadier Fréron, du 10me chasseurs à cheval, tombé pour la France vers Moulinelle, le 6 ou 7 août. Ce fut le matin du 9, après la Messe, que les fidèles, en très grand nombre, accompagnèrent la glorieuse dépouille jusqu'au champ funèbre où elle repose encore.
Le lendemain 10, la première victime civile y était transportée. Obéissant à un ordre donné (1), M. Joseph Collignon portait ses deux fusils de chasse à la mairie.
(1) Sage précaution, qui réfute à l'avance les imputations allemandes. Si la population avait été démunie de ses armes, comment aurait-elle pu tirer sur les troupes?
Il rencontre Mme Morin et s'attarde à causer. Ce fut sa perte. Tout à coup, d'un coin de rue débouche une forte avant-garde à cheval. A la vue de cet homme muni d'armes, les Allemands tirèrent-ils précipitamment? Lui-même, apeuré, esquissa-t-il un mouvement de fuite qui provoqua les coups de feu? Toujours est-il que, manqué, poursuivi jusque dans la grange de Mme Morin, malgré ses supplications, il y fut percé de lances qui l'abattirent. Relevé brutalement, traîné à la mairie et se sentant mourir, il réclame le prêtre, que va chercher un membre de la Croix-Rouge locale. L'abbé Léon Vouaux accourt, bravant avec son guide les menaces des groupes de soldats. Il est même malmené par l'un de ceux qui entourent l'agonisant. Mais qu'importe, il élève la voix, expose en allemand son devoir urgent, si bien qu'un officier, sans mot dire, fait brusquement pivoter le soudard et laisse le prêtre consoler les derniers instants de M. Collignon, qui expire bientôt.
En hâte le maire fait confectionner un cercueil; et le cortège mortuaire s'organise. Mais à la sortie de la localité, sur la route du cimetière, les balles sifflent. L'abbé, plus préoccupé des autres que de lui, les exhorte à rester à l'abri, et seul avec les porteurs, s'en va bénir le corps descendu dans la tombe.
Le lendemain de cette journée mouvementée, l'abbé Léon Vouaux goûta l'une des rares satisfactions de son calvaire. Elle dut être bien profonde pour son cœur si sensible à l’amitié.
Inopinément se présenta devant lui M. l'abbé Bruneau, qui de Nancy se rendait à Joeuf pour y remplacer le curé, mobilisé comme celui de Jarny. C'était d'une héroïque imprudence. On se demande même comment ce prêtre réussit à passer à travers les troupes et à gagner la paroisse où il exerça un an et demi son ministère avant d'être emprisonné par les boches.
Quoi qu'il en soit, aidé par nos chasseurs à pied, M. l'abbé Bruneau arrivait le soir du 11 au presbytère. Il est facile de s'imaginer la surprise, la joie, l'accueil de l'abbé Léon Vouaux! Ce furent des heures ravissantes. Si les deux amis échangèrent leurs appréhensions, elles ne ternirent pas l'habituelle et saine gaieté de leurs entrevues et n'affaiblirent pas leurs résolutions. Eussent-ils voulu fuir le danger, qu'ils auraient choisi des lieux de refuge autres que Joeuf et Jarny.
Le 12 au matin, après une dernière accolade, il se séparèrent. L'abbé Léon Vouaux ne connaîtra plus pareil réconfort. Ce fut en vain que le R. P. Dublanchy, mariste, remplaçant alors le curé de Bruville, tenta de le voir : il ne put même entrer à Jarny.
**
Après les journées sanglantes, celle du 14 août compte parmi les plus troublées, les plus inquiétantes.
Dès les premières heures du matin, deux chasseurs à pied s'étaient embusqués à l'entrée de la localité, du côté de la tuilerie, derrière le mur du jardin de M. Thonon. De là ils surveillaient les bifurcations de la route vers Labry et vers Conflans.
Bientôt paraissent deux cyclistes allemands. Des coups de feu éclatent. Deux ennemis tombent, l'un tué, l'autre blessé. Tandis que les balles de la riposte s'aplatissent sur les maisons, nos deux chasseurs regagnent paisiblement leur compagnie vers Droitaumant, sans se douter des conséquences de leur initiative.
Le blessé, transporté à l'infirmerie de la Croix-Rouge, n'a pas vu ou du moins reconnu l'uniforme des Chasseurs, mais il crie tout haut que les civils ont tiré sur son groupe. Grand brouhaha, vociférations parmi les camarades, venus déjà plus nombreux! Ils arrachent de leurs demeures une douzaine d'habitants et les plaquent sous bonne garde au mur de la mairie.
A l'intérieur du bâtiment et dans le bureau de poste voisin la scène est indescriptible. Les meubles brisés, les paperasses administratives déchirées jonchent le sol. Les menaces retentissent et s'aggravent. Le maire et quelques conseillers, enfin réunis, discutent avec les chefs et rejettent la responsabilité durant ces longues et pénibles négociations on vit passer et repasser l'abbé Léon Vouaux. Y eut-il un rôle? Allait-il simplement à la mairie pour un cas particulier? La chose n'est pas éclaircie. Mais il eut sa part des avanies soldatesques, car il reçut encore ce jour-là un coup de crosse qui lui mit le visage en sang.
Enfin un arrangement se conclut. De l'argent, une quantité de bouteilles de vin et de bière paieront la mort de l'Allemand, dont le corps, mis dans un cercueil sur une voiture, sera mené honorablement vers la frontière. Néanmoins le maire devra disculper sa commune devant les grands chefs de Metz.
On en était au milieu de l'après midi, quand sur la route de la gare s'avance une troupe française.<< Franzose! Franzose! >> Les boches prennent peur, rompent en toute hâte leurs faisceaux et disparaissent vers Doncourt, sans s'inquiéter des habitants qui, arrêtés le matin, attendaient à chaque instant leur exécution, et à ce moment retournent tranquillement chez eux.
Par malheur les ennemis avaient eu le temps d'emmener leur otage. L'abbé Léon Vouaux va s'occuper de sa délivrance. C'est lui qui, aussitôt que possible, rédige l'exposé des faits, en donne lecture au Conseil municipal qui l'approuve, et l'adresse aux autorités militaires allemandes.
Quel fut le sort de cette supplique? Eut-elle influence pour un traitement meilleur du prisonnier. Le vaillant M. Génot, qui, tombé malade à Metz, y retrouva la santé de l'âme et un peu de vigueur corporelle, n'est plus là pour nous renseigner.
L'affaire du 14 août ne coûta qu'une victime à la population, un pacifique italien blessé mortellement par un soldat allemand.
Eut-elle des suites plus graves? Fit-elle inscrire Jarny, comme on s'est plu à le répéter, parmi les localités à maltraiter? Il se peut. En tout cas, elle fut loin de tranquilliser les habitants : et plus que jamais grandit le rôle de l'abbé Léon Vouaux.
LA TROISIEME SEMAINE
Dès le lendemain, 15 août, fête de l'Assomption, l'occasion se présentait d'atteindre l'ensemble des fidèles. Ce que fut la prédication du jour, cela se suppose facilement. Un cheminot qui, revenu pour chercher sa femme, assistait à la Messe, résume l'impression générale en écrivant plus tard : << M. l'abbé encourageait si bien tous les paroissiens!>>
C'était nécessaire, avec l'occupation graduellement plus accentuée du pays. <<D'un courage admirable, il se multiplie, exhortant la population au calme, donnant les conseils de la plus extrême prudence, défendant les attroupements qui pourraient irriter un ennemi aussi soupçonneux.>>
Aux affligés surtout, l'abbé prodiguait les meilleures paroles de consolation, les visitant souvent, unissant ses ferventes prières aux leurs, car elles étaient pour lui-même le seul vrai réconfort.
En effet, loin d'être insensible aux tristesses et aux dangers de la situation, il les ressentait profondément, au point d'en paraître parfois accablé. Il supporte avec peine la privation de nouvelles au sujet de son frère et de la France. C'est ce qu'il répète presque uniquement dans deux cartes postales, dont l'une est datée du 20 août.
Mais il recherche et saisit l'occasion de lire les lettres et les journaux introduits à travers les armées, il trouve plus haut la force morale pour lui et les paroissiens. Il les convoque à de pieuses réunions à l'église; il prie; il se prépare ainsi au sacrifice qui l'attend.
C'est le matin du dimanche 23 août. Mme N... aborde l'abbé Léon Vouaux pour un renseignement; Elle est toute saisie de son aspect : << On eu dit qu'il était détaché de la terre et ne regardait que le ciel : on eût dit un saint.>>
Mme B... lui avait demandé une Messe pour sa fille et voulut lui remettre les honoraires. <<Gardez-les, Madame>> répondit l'abbé, << Dieu sait si je pourrai vous contenter.>> Il la célébra cependant le surlendemain, cette Messe, et ce fut la dernière.
Il ne se départait de son calme, dicté par son énergique volonté. Au milieu de vêpres de ce dimanche, suivies par une cinquantaine de courageux fidèles, une femme affolée se précipite dans l'église en criant : << Voilà les Prussiens!>>
Mais l'abbé Léon Vouaux élève la voix, annonce simplement qu'il ne faut pas craindre, qu'on terminera plus rapidement les chants, et que chacun rentrera chez soi sans inutile provocation. Cela suffit pour apaiser le brouhaha naissant. Personne ne sortit. Et pendant que ces vaillants, mâtant leur émoi, achevaient cet office qu'aucun prêtre français ne présidera plus avant la fin de novembre 1918, les troupes allemandes défilaient en masse profondes dans les rues de la localité, sur la route de Metz à Verdun.
La consommation du sacrifice
----
LE 24 AOUT
Interrompu le 23 août, vers 10 heures du soir, le passage des régiments reprend de plus belle le 24 dès 6 heures du matin. L'enthousiasme des soldats est grand; ils chantent; et au milieu de leurs exclamations, l'une d'elle revient sans cesse : << Verdun, cinq jours!... Paris, huit jours!>>
Le sourire sceptique des jarnisiens palliaient l'angoisse que leur causait la vue de ces nombreuses troupes et leur splendide armement.
Puis, une nouvelle presque rassurante se répand :<< Le maire est ramené! le maire est rentré! >>
C'était vrai. M. Génot, sorti un peu plus fort de l'hôpital messin et désireux de revoir les siens, avait accepté de prendre place dans un convoi et de retourner à Jarny, sans s'illusionner sur le péril personnel qui le menaçait.
Aussitôt que l'abbé Léon Vouaux en est prévenu, il accourt, heureux du soulagement qu'on pouvait espérer pour sa famille inquiète, heureux de saluer le compagnon de responsabilité dont il avait tenté la délivrance.
L'accalmie ne fut pas de longue durée.
Durant l'après-midi, l'abbé, écoutant la canonnade qui résonnait au loin dans la direction de la Meuse, se tenait au jardin. C'est là que vint le chercher M. Grimard, qui s'était d'abord présenté à la cure.
Un ordre allemand pressait. Chez le maire, les deux adjoints, MM. J. Louis et L. Grimard, étaient convoqués avec le <<pasteur>> pour s'entendre tous quatre déclarés responsables de l'attitude de la population. << ...Si les habitants tirent sur nos troupes, vous serez fusillés!>>.
M Génot à beau s'efforcer de dépeindre la composition de la localité , d'expliquer que si les autorités municipales peuvent répondre des éléments français, elles n'ont aucune influence sur les élément étrangers : les Allemands ne veulent rien entendre ... << Au premier acte d'agression vous serez fusillés...>> La tuerie se préparait.
LE 25 AOUT
Les combats du 24 et 25 août dans la Woëwre furent un grave échec pour les allemands. Un certain nombre de blessés furent transportés à Jarny.
Leurs conducteurs eurent à subir quelques quolibets : << Comment? Vous êtes déjà revenus de Paris? Voua allez vite!>>
Mais bientôt les Jarnisiens n'ont plus le cœur à plaisanter. La guerre leur inflige toutes ses horreurs. Les quelques scènes qui vont être rappelées ne donnent qu'une vague idée de l'angoisse et de la terreur de ces épouvantables moments.
Dès la matinée du 25, les Allemands tentent une diversion et leurs troupes, appuyées de plusieurs pièces de canon, défilent encore dans les rues.
Le chef de la manœuvre aurait été le général Pelkmann, commandant l'artillerie de la forteresse de Metz. mais il ne l’inspira pas, il ne manqua pas de se conduire en assassin. Protestant, il détestait les prêtres catholiques, ceux de la Lorraine annexée comme ceux de la France, et ne perdait aucune occasion de vitupérer contre eux. En revanche, il appréciait les bonnes eaux-de-vie du pays; il aimait en avoir toujours un flacon dans son auto.
Au commencement de l'après-dîner, la canonnade se rapproche. L'artillerie française tire des environs de Friauville. Des obus arrivent jusqu'à Jarny et atteignent plusieurs maisons, au centre de la localité et à la gare. Les balles sifflent, tantôt isolées, tantôt en rafales.
Vers ce moment, le général Pelkmann, arrêté devant la mairie, fait mander M. Génot et veut voir les blessés installés dans l'ambulance locale. Sa visite lui prouve que les soins sont excellents, et de retour sur la place, il félicite et remercie le maire.
Les compliments sont-ils sincères? Ils ne l'empêchent pas d'ajouter immédiatement : << ...Vous êtes responsable de l'attitude des habitants....>> M. Génot répète ce qu'il a dit la veille, ce qu'il répétera jusqu'à la dernière minute, sur la composition de la population. Le général en conclut qu'il faut rassembler les éléments peu sûrs, qui seront emmenés par la troupe. Puis il s'en va.
Comment l'ordre de réunion à-t-il été transmis et compris? En pareilles circonstances on ne dut guère peser les termes de la publication. Quoi qu'il en soit, une ou deux heures plus tard, quelques dizaines d'italiens étaient regroupés dans la cour de la mairie, et un bon nombre de familles françaises dans les caves des écoles, après avoir échappé aux dangers de la rue.
**
Tous n'eurent pas cette chance.
M. Ernest L'hermite, revenant du lieu de son travail, allait tranquillement rentrer chez lui, dans la maison Louis (aujourd'hui rasée), quand de l'autre côté de la place un soldat lui tire un coup de fusil. L'infortuné s'écroule. Malgré le péril, des infirmiers bénévoles accourent et le transportent à l'ambulance. L'abbé Léon Vouaux, prévenu, arrive à temps pour lui donner l'extrême-onction avant son dernier soupir.
Dans la Grand'Rue, des maisons commencent à flamber : les engins incendiaires, pastilles et autres, y ont mis le feu, car << il fallait punir les habitants>> Et pourquoi?
Vers 3 heures, un obus est tombé sur la Maison Sacré : ses éclats, paraît-il, blessent plusieurs officiers qui passaient en automobile. Un peu plus loin, près de Rougewald, un autre éclat fend la tête d'un soldat.
Fait de guerre, certes, mais qui surexcitent des hommes déjà furieux. Ils appartenaient a-t-on su plus tard, à un régiment de bavarois, à celui-là même qui venait de s'illustrer aussi tristement à Nomeny. Ils tirent comme des fous sur de prétendus adversaires; ils se ruent dans les maisons voisines. De la cave de M. Bérard, où, tout tremblant, il s'était réfugié avec sa famille, ils arrachent un malheureux Italien, naturalisé français, M. Aufiéro, et l'accusent d'avoir tué leur camarade. Ils le frappent brutalement et, malgré les supplications de sa femme, le fusillent sur le champ.
Dans la maison voisine, le drame est plus poignant encore.
Pour échapper aux flammes, M. et Mme Pérignon, leur fils Fernand, âgé de dix-sept ans, leur fille Mme Leroy et leur petit-fils âgé de huit mois, durent se réfugier dans la cour.Les Bavarois les découvrent et abattent d'abord les parents. Le pauvre Fernand s'étant relevé et traîné quelques mètres, est achevé à coups de pieds et de crosse de fusil. La jeune mère ne sait pas comment elle passa au travers des barbares, la main broyée, emportant l'enfant qui mourra peu de temps après.
C'est aussi en fuyant sa maison en feu que Mme Bérard, entourée de ses enfants et de la famille Aufiéro, eut l'indicible douleur de voir frapper son fils de cinq ans, Jean, qu'elle portait dans ses bras. A ses côtés, deux fillettes Aufiéro étaient blessées, l'une à la jambe, l'autre à un bras, qui dut être ensuite amputé.
Faut-il rappeler ce que beaucoup se refusent à croire et qui est un fait réel? Pour sauver sa vie et celle des autres enfants, la mère dut se jeter aux genoux de celui qui commandait ce détachement de bourreaux, et fut contrainte de commencer la fosse où l'on étendit le petit corps.
Et << c'étaient les habitants qui tiraient sur les soldats! >>
Pendant le même temps, à l'autre extrémité de Jarny, vers le chantier Pagny, deux ouvriers inoffensifs sont tués dans des circonstances inconnues.
Plus loin, au quartier de la Gare, un groupe d'Allemands qui se rabattaient sur la localité, saisissent au sortir de sa cave, M. Fournier, que son jeune neveu, Henri Menne, voulut suivre, les font monter en auto, puis descendre près du petit cimetière Bertrand, au côté de la maison Perrin. Et là, tout de suite, un feu de salve les couche à terre. On vit l'un d'eux essayer de se relever, mais une deuxième salve termina son agonie.
Au centre même de Jarny, devant la mairie où se tiennent les Italiens rassemblés, des soldats qui passent en voiture entendent siffler des balles, tirées certainement par leurs compatriotes, prétendent qu'elles viennent des groupes de civils et se mettent à les viser, faisant plusieurs victimes, tuées ou blessés.
**
C'étaient là de tragiques épisodes, que l'affolement des Allemands dans leur flux et reflux pouvait encore expliquer. Mais que penser du sort infligé aux otages?
<< Pour leur faire constater que des civils avaient tiré sur la troupe >> et leur faire reconnaître le corps d'un prétendu coupable, un officier supérieur les avait envoyé chercher à la mairie. Les soldats ne se contentèrent pas de MM. Génot, L. Grimard, J. L'hermite, membres du conseil municipal. Il fallut que le maire trouvât d'autres personnes, qui, sorties des caves de l'école plus par persuasion que par ordre, composèrent le petit groupe représentant alors la population. C'étaient MM. J. Collier, N. Parisot, N. Binz, pères de famille, et deux jeunes gens, J. Bernier et F. Fidler.
Mais l'ennemi voulait surtout le << pastor >>, considéré par lui comme le plus redoutable, et le réclamait à grands cris.
Où était l'abbé Léon Vouaux? Où l'appelait son devoir de pasteur.
Il venait de quitter l'infirmerie et était rentré dans l'église, soit pour y déposer les saintes huiles, soit pour y consommer les hosties consacrées et les préserver ainsi du feu ou de la profanation. Il y voit réfugiées plusieurs femmes <<apeurées>>, les apaise, les encourage et les décide à gagner la cure, dont la cave voûtée les protégerait mieux que le toit de l'église.
L'installation se préparait, et l'abbé était remonté prendre un tapis pour l'étendre sur le sol trop humide, quand les paroissiennes restées à la cave entendirent un coup de sonnette, puis quelque bruit, suivi d'un profond silence. Ne voyant plus redescendre l'abbé, elles finirent par dompter leur frayeur et rentrèrent chez elles.
L'abbé Léon Vouaux avait été emmené par des soldats et, à l'intersection des routes de Nancy et de Metz, réuni aux autres Jarnisiens, conduit avec eux vers le bas du village. Avant d'y arriver, M. L'hermite parvint à fuir dans son jardin, d'où, caché; il voyait brûler sa maison.
Au-delà, près du pont, écrit un rescapé (mort depuis), << nous avons vu sur le trottoir gauche un Allemand mort, et à droite dans le fossé, le corps d'Aufiéro, criblé de balles. Le commandant du bataillon nous a dit qu'il venait de le faire fusiller parce qu'il avait tué un soldat, et qu'il avait fait mettre le feu dans plusieurs maisons pour punir les habitants...>>
Que répondre aux accusations sur des faits dont on n'est ni la cause ni témoin, sinon en décliner la responsabilité, voire les contester? De la discussion le chef de ce détachement tire une conséquence qui montre son état d'esprit.
<< Nous allons traverser le village; et le camp sera établi de l'autre côté. Vous marcherez devant la colonne. Et si les habitants ne tirent plus sur nos troupes, vous n'aurez pas à craindre pour votre vie, vous serez libres demain matin. >>
Des commandements retentissent. Les rangs se forment. Moitié des prisonniers sont placés en tête ou sur les côtés, moitié derrière. L'abbé Léon Vouaux a pris le bras du maire en lui disant: << Montrons-leur, M. Génot, que le courage ne nous manque pas>>. Et tous se mettent en route, au milieu des maisons qui flambaient.
Un peu plus loin, dans un immeuble encore épargné, Mme G.. cachée par ses persiennes, épiait la rue. << J'ai vu passer votre frère devant les Boches.>> disait-elle en 1915. << Il marchait d'un bon pas, sans l'air d'avoir peur.>>
Cette attitude décidée n'empêchait pas les insultes et les menaces ennemis. Un Messin, qui longeait la colonne, les entend et les remarque, sans y ajouter d'importance à ce moment-là.
En effet, la traversée du centre de Jarny se fit heureusement. Aucune balle n'atteignit la troupe, qui s'arrête et campe à proximité d'une batterie dont le tir répond à l'artillerie française.
Là des débats reprennent entre officiers et prisonniers, ceux-ci réfutant les imputations de ceux-là. Bref, maire, abbé, officiers redescendent vers la mairie d’où ils reviennent assez vite.
Il semble que les autorités locales avaient prouvé l'inanité des accusations, car les autorités allemandes, ce soir-là, permirent à tous les captifs de retourner à Jarny pour s'y restaurer, sous la surveillance de quelques militaires.
De plus, en passant devant les écoles, M. Génot fait informer les habitants réfugiés dans les caves que le danger n'est plus pressant, qu'ils peuvent sortir et rentrer chez eux pour la nuit. Il était environ huit heures.
La famille Génot avait rapidement préparé un léger repas, auquel tous les compagnons d'infortune furent conviés. Et même, en signe d'accommodement, le chef du petit détachement allemand y participa.
Il dut être satisfait, car il laissa le prêtre aller au presbytère pour y prendre une couverture. De sa fenêtre, Mlle K..., l'une des personnes que l'abbé Léon Vouaux avait voulu protéger quatre ou cinq heures auparavant, le vit avec deux soldats entrer à la cure, où il resta très peu de temps : il ne devait plus y revenir. Il emportait non seulement un préservatif contre l'humidité, mais surtout le livre de prière sacerdotal, son bréviaire, qui contribuera à maintenir sa force d'âme.
C'est durant ce court trajet qu'il fut aussi aperçu entre ses gardiens par le Dr Bastien, dont il estimait les relations cordiales. Mais l'abbé pratiquait la prudence charitable qu'il recommandait aux autres. << Il détourna la tête avec intention, par crainte de le compromettre >>.
A trop juste titre il était méfiant, malgré l'accalmie du moment. Il le disait nettement quelques instants plus tard. M. Génot venait de recevoir les adieux de sa famille; La réponse n'est pas oubliée. << Du courage, nous en aurons, madame. Mais avec de pareille brutes sait-on ce qu'il adviendra? >>
Un de ses compagnons gardait alors plus de confiance. << A 9 heures, écrit-il, nous allions reprendre notre poste, avec l'espoir d'être libres le lendemain matin >>.
LA NUIT DU 25 AU 26 AOUT
De fait, tout parut d'abord en bonne voie d'arrangement. Au lieu de laisser en plein air leurs prisonniers, les Allemands les font entrer dans le café de Belle-Vue où les propriétaires, M., Mme Blanchou et leur fille étaient déjà surveillés en compagnie de M. Froschard, M. et Mme Reisch et leur petit-fils.
Pendant une heure ou deux, la petite salle semblait plutôt un lieu de réunion amicale, où des groupes échangeaient paisiblement leurs réflexions. Les deux officiers allemands eux-mêmes conversant avec le prêtre et le maire, fumant et se rafraîchissant comme les autres, paraissaient de bonne composition.
Mais voici que brusquement, entre 10 et 11 heures, les coups de feu reprennent avec violence, accompagnés et suivis de cris effrayants.
C'est la soldatesque qui tire au hasard dans les rues et dans les maisons, sous l'empire de la peur et de la boisson, et qui hurle sa fureur. Ses chefs en sont-ils encore les maîtres? Il est certain que l'un d'eux, pour échapper aux balles, conseille à la famille qui l'héberge de l'imiter en se couchant à plat ventre sur le plancher.
C'est la population qui clame son épouvante, soit que dans la rue principale elle fuie l'incendie de nouveaux immeubles, soit que dans les rues adjacentes elle s'attende au massacre.
Le tumulte est tel qu'à deux kilomètres il réveille et terrifie les habitants de Labry.
Et bientôt de Labry, de Droitaumont, des extrémités de la bourgade, tous ceux qui osent se risquer au dehors aperçoivent un spectacle qui les a si vivement frappé, qu'aujourd'hui encore ils en parlent avec saisissement.
Des soldats ont pénétré dans le clocher, et en tirent des coups de feu que leurs camarades attribuent à des civils : invention qui durant la guerre ira s'amplifiant parmi les troupes allemandes, au point de vue qu'elles accuseront maire et curé, alors prisonniers, d'avoir employé contre elles .... une mitrailleuses!
La vengeance (!) ne tarde pas. La réserve de pétrole et de luciline d'une épicerie voisine en fournit les moyens. Les escaliers et les planchers du clocher forment bien vite une fournaise activée par le tirage de la vieille tour.
Le feu gagne le support des cloches, atteint la charpente de la flèche. La chaleur soulève les ardoises et les encadre de lignes flamboyantes. Et dans la nuit, meurtrières, fenêtres, damier de la toiture rougeoient, scintillent, rutilent au-dessus des autres incendies, jusqu'à ce que, horloge, poutres et cloches se fussent abîmées avec fracas dans les flammes et sur le sol.
En même temps, des brandons tombés du faîte communiquèrent le feu à la sacristie qui reliait la tour au chœur de l'église, et la brûlèrent entièrement... On n'a jamais compris comment la toiture du sanctuaire échappa elle-même au désastre.
Cependant les murs de l'antique clocher sont si épais qu'ils ne subirent alors aucun dommage appréciable. Huit ans après, l'un des cadrans d'horloge, suspendu aux ruines, marquait encore l'arrêt du mécanisme : 2 heure 1/2 du matin.
Témoin de l'incendie de la flèche, mais ne pouvant apercevoir la base du clocher, l'abbé Léon Vouaux eût voulu connaître l'étendue du désastre; il répéta plusieurs fois : << Pourvu que la sacristie et le presbytère ne brûlent pas! >>.
Un moment, en effet, les prisonniers pouvaient sortir, au moins individuellement, et contempler le lugubre spectacle de la localité en flammes.
Mais bientôt ils furent renfermés et surveillés plus strictement. Un ou plusieurs soldats, arrivés en courant, venaient de communiquer un ordre aux deux officiers présents dans la salle. L'un disparaît sur-le-champ. L'autre dépouille son apparente bienveillance, crie au maire : << Vos habitants tirent sur nos troupes! >>, dit en allemand quelques paroles à l'abbé, qui répond simplement : << Comme vous voudrez. >>, et dès lors, quand il doit passer devant eux, se tient muet, raide, sans tourner la tête, comme s'il ne les voyait pas.
Qu'avait-il annoncé au prêtre? Les survivants ne l'ont pas compris. Mais lorsque, avant de chercher un peu de repos, qui sur une chaise, qui sur un bout de table, qui sur le plancher, ils s'entretenaient de leur espoir de passer seulement une mauvaise nuit et d'être relâchés au matin, l'abbé leur déclara :<< Vous, oui! mais pas M. le maire ni moi! >> Il se savait déjà condamné à mort.
Quelle dut être pour lui cette nuit d'agonie?
Et comme on compatit à l'état d'âme de M. Génot ramenant sa coiffure devant ses yeux et pleurant un instant, après qu'un geste trop expressif de l'abbé fut la seule réponse à sa demande : << Insistez donc pour savoir ce qu'ils vont faire de nous! >>
Y a-t-il eu jugement? Un conseil de guerre a-t-il été tenu par les officiers qui dans l'après-midi du 25 avaient été difficilement apaisés? Cela se peut. Mais en tout cas les accusés n'ont comparu devant aucun tribunal, n'ont été ni interrogés, ni admis à se défendre.
LE 26 AOUT
D'ailleurs cette inique décision n'eût pas alors été prise que néanmoins les malheureux auraient subi le même sort. Ainsi l'avait décrété de son côté le général Pelkmann.
Revenant de la direction de Metz, il était arrivé de très grand matin à l'entrée de Jarny. Là une sentinelle arrête son auto et lui raconte que les habitants tirent sur les troupes, même du haut du clocher, et qu'il est dangereux de passer.
Fureur du général, qui au milieu de ses vociférations donne l'ordre de fusiller, entre autres, le maire et le curé! Quelques heures plus tard, un peu calmé, loin de revenir sur sa sentence, il a le cynisme de répondre au Messin son conducteur, qui hasarde un mot en faveur des captifs : << J'ai pris ma décision en conscience. Je ne me reproche rien. Le gros maire sera fusillé parce qu'il a été déclaré responsable de la population. Le curé sera fusillé parce qu'il a laissé son église ouverte et a permis ainsi de monter dans le clocher (1). Le commandant d'étape qui va être nommé verra ce qu'il faut faire des autres. >>
(1) Si ce triste justicier avait eu la <<conscience>> d'inspecter un instant les lieux, il aurait vu que les entrées de l'église et du clocher sont complètement indépendantes l'une de l'autre.
Est-ce à la suite de ses ordres? Vers 5 heures les gardiens furent remplacés par d'autres. Jusque là, malgré tout, les prisonniers avaient encore eu un peu de liberté. Mme Reich et son petit-fils avaient été autorisés à regagner leur logis. M. Grimard, comme adjoint, était sorti pour diriger la corvée chargée d'inhumer le corps de l'Allemand tué près de Rougewald. Quelques convoyeurs, soit par curiosité, soit par hostilité, s'étaient approchés des prisonniers; les survivants ont conservé l'amer souvenir de certaines discussions proférées, hélas! en langue française.
Par le nouveau poste, ils sont traités plus durement. << Ils nous fait sortir, écrit M. Collier, et nous aligne le long de la façade de la maison, avec défense de nous parler et de nous regarder. Nous sommes restés dans cette position, au soleil, jusqu'à l'arrivée du major, qui a réuni le peloton d'exécution. >>
La soif tourmentait les infortunés. Mais une fois seulement il fut permis à Mme Blanchou de leur apporter de l'eau.
Il était interdit d'approcher d'eux. Une pauvre femme en pleurs qui le tenta, Mme P...; attira sur elle et sur son mari de telles menaces, que M. Génot dut les avertir du danger d'insister.
Ce fut à lui encore que très probablement M. Grimard dut la vie.
Sa corvée finie, celui-ci, répugnant à se cacher de peur de surexciter davantage la rage des envahisseurs, venait rejoindre ses compagnons. Une sentinelle l'arrête. M. Génot lui fait signe de s'éloigner. L'adjoint ne se rendant pas compte de la situation et insistant pour passer, le maire risque d'attirer sur lui-même les brutalités des gardes en disant : << Qu'est-ce que tu viens faire ici? Va-t-en! >> M. grimard fit enfin demi-tour et fut sauvé.
Mais que cet épisode met en relief l'arbitraire inqualifiable dont les otages furent victimes!
***
Par ailleurs, la cruauté allemande s'étalait toujours dans sa hideur sanglante.
Au matin, huit ou neuf Italiens furent conduits sur la place centrale (Elle est appelée maintenant " Place Henri Génot ">>, au débouché du chemin de la Cartoucherie, et obligés de creuser une espèce de tranchée. Était-ce prémédité? Fut-ce un nouvel accès de fureur? Toujours est-il que les Boches, prétextant la lenteur de la besogne, se mirent à tirer des coups de revolver sur les travailleurs et les abattirent dans la fosse ouverte, où ils les laissèrent sans vie.
C'était à 200 mètres environ de la maison Blanchou. Si les prisonniers entendirent ces coups de feu et ne les confondirent pas avec ceux qui crépitaient partout, ils se demandèrent quand viendrait leur tour. D'autant plus que les sarcasmes, injures, menaces ne leurs étaient pas épargnés par les soldats qui passaient devant eux.
Une chance de salut leur fut présentée inopinément.
Vers 10 heures, le général Pelkmann revenait de Conflans, où seule la vitesse de son auto empêcha une patrouille française de le capturer ou de le tuer. Il fit stopper et descendit devant les malheureux, allant et venant avec les officiers, et leur renouvelant probablement ses ordres.
L'abbé Léon Vouaux saisit cette suprême occasion. Il s'adresse au sous-officier de garde, lui expose son projet de s'offrir lui-même, seule victime, pour sauver ses compagnons et épargner la localité. Il met une telle âme en sa requête que cet homme en est touché et risque d'avertir le général, vers lequel ils font tous deux quelques pas.
Ce ne fut pas long. Instantanément, le soudard tourne le dos au prêtre, profère un tranchant << rien à faire!>> et, avant de remonter en voiture, invective son trop compatissant sous-ordre comme savent s'y prendre les supérieurs allemands.
<< A partir de ce moment>>, écrivit plus tard M. Collier, <<nous avons compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Votre frère n'a plus levé les yeux de dessus son livre, et à pris à sa main le crucifix (de 0.15m environ) et ne l'a plus quitté. Je lui ai demandé de bien vouloir dire pour nous les dernières prières : il m'a simplement regardé sans répondre...>>
Il a été retrouvé, ce bréviaire dont l'abbé Léon Vouaux usait depuis son sous-diaconat. Les signets sont encore aux pages où il les plaça; il indiquent que les prières assignées au matin ont été dites, et que celles du soir sont préparées.
( Manque la fin de la page 45 du texte)
<< On va fusiller des espions!>> Sans le vouloir, les bourreaux préparaient les témoins de leur crime.
Von Kayser s'avance vers la ligne des prisonniers, tout en brandissant son revolver, << et se met à crier à quatre reprises : Vous allez mourir!>> puis sans autres paroles, il fait avancer du côté Est de la maison, M. Génot et l'abbé Léon Vouaux, facilement reconnaissables.
<< Là encore, votre frère a voulu parler : il ne l'a pas pu >>. Et comme il portait toujours en évidence sa crois, l'ordre lui est intimé trois fois de la cacher. Trois fois, l'Abbé semble ne rien entendre. Alors, un jeune lieutenant lui arrache des mains le crucifix, qu'en ricanant il montre à von Kayser et enfouit dans sa poche.
Mais les deux adjoints eux aussi dans la soirée du 24, avaient été déclarés responsables de la population. Qui complétera le nombre de quatre? Le major hésite, et finalement choisit, on ne sait pourquoi, les deux jeunes Jean Bernier et François Fidler. Il est dès lors satisfait, écoute les protestations d'innocence des autres condamnés et d'un bref commandement les fait reculer et rentrer dans la maison.
Dans une troupe qui passait, von Kayser recrute des volontaires pour fusillers les <<espions>>. Et tandis que le petit peloton se formait en contre-bas du chemin, les quatre infortunés, face aux soldats, face à la bourgade, purent sentir longuement le frisson de l'agonie, car avant de les mettre à mort, on attendit l'écoulement d'un régiment.
Mais ce fut une grâce providentielle. Aucun aumônier allemand ne s'était présenté. L'abbé Léon Vouaux - on l'a entendu - prépara ses compagnons au sacrifice suprême et leur donna l'exemple de la résignation. Debout, tête nue, les mains croisées, tenant son chapeau tout en serrant le chapelet qui avait remplacé le crucifix, il garda sans défaillance son attitude habituelle, simple et résolue. Un seul geste, une seule et rapide élévation des mains, pendant le passage interminable de la troupe, marqua le désir d'être plus vite délivré du supplice.
A ses côtés, M. Génot, accablé de fatigue, sans coiffure sous l'ardent soleil, semblait toujours ne rien comprendre à l'inique sentence et ramasser ses forces pour rester debout lui aussi. François Fidler et Jean bernier, alignés à la suite, pleuraient à chaudes larmes.
Et voici que tout à coup l'officier chargé de l'exécution, mû par on ne sait quel sentiment (1), avance au milieu des condamnés, étend le bras du côté du prêtre et du maire en criant : << Hier, nicht Kathokiken : Ici, pas de catholiques! >>, puis s'écarte, pendant que les soldats se placent selon leur religion devant les victimes désignées à leurs coups.
(1) Un autre officier, le capitaine Hepk, du 65me, 1re compagnie, procureur impérial au tribunal de Dusseldorf, de religion catholique, avait failli présider à l'exécution, mais il sut s'esquiver à temps. Plus tard, en parlant de ces faits à un prêtre prisonnier, il ajoutait : << Cest horrible! >> (Cf. Bulletin de la Malgrange, années 1916-1917).
Quelques secondes encore. Les fusils sont épaulés, le feu commandé... Et les quatre corps s'affaissent sur le chemin, baignés dans leur sang.
L'abbé Léon Vouaux est tombé en avant, les bras écartés, les cheveux voilant son front, << une affreuse blessure derrière l'épaule gauche >>. Le coup de grâce, tiré tout de suite après, fit un petit trou vers la tempe. On ne remarqua aucune autre mutilation.
A la montre d'un des rescapés il était à ce moment-là 11 heures 30.
Un médecin de Longeville-les-Metz, fut chargé de constater la mort des otages. Il se redressa, a-t-on remarqué, plus pâle que son cheval blanc.
Bientôt après, le convoi de ravitaillement reprenait sa marche. De leur côté, les survivants de la maison Blanchou étaient emmenés à Conflans et emprisonnés.
Environ une heure plus tard, à quelques dizaines de mètres, se passait un autre épisode dramatique. Un douanier retraité, M. Plécis, était saisi par les Allemands malgré ses protestations d'innocence, et son <<affaire>> vite réglée. Le temps de voir mettre le feu à sa modeste demeure, jaillir les premières flammes: le pauvre homme tombait assassiné, sous les yeux de sa femme, plus morte que vive.
Ce fut le dernier sang versé à Jarny le 26 août. Ainsi s'accomplit presque à la lettre le suprême souhait du bon pasteur, de l'abbé Léon Vouaux.
Monument dû au sculpteur Victor Huel, de Nancy.
Cliché de M. Mettavant, photographe à Jarny.
L'holocauste des otages contribua-t-il à sauver le reste de Jarny. C'est le secret de Dieu. Car qui connaîtra sur ce point les documents ennemis?
Ce que plusieurs Jarnisiens ont entendu, c'est que tout le quartier de la gare devait être mis à feu et à sang comme le centre. Or rien n'y a été touché. Et les démarches possibles à ce moment-là ne semblent pas avoir obtenu beaucoup de résultat.
Ce qui est certain encore, c'est que la défense d'éteindre les incendies, appliquée toute la journée du 26, a été infirmée le 27 par un ordre venu de Metz.
D'après un témoignage, la relation entre les deux faits serait évidente. L'aumônier protestant d'un état-major installé à l'Hôtel Cordier aurait voulu savoir exactement pourquoi le curé de la paroisse avait été fusillé. Il se rendit donc au lieu de l'exécution, et trouva sur le corps du prêtre un carnet de notes qu'il feuilleta. Et tout impressionné il aurait dit ensuite : << Qu'a-t-on fait? Ce n'est pas le pasteur de la localité! C'est abominable! Ce prêtre était une nature supérieure... Il faut faire cesser les massacres par tous les moyens, recourir même à l'Impératrice ...>>
Mais s'il est vrai que l'abbé Léon Vouaux rédigeait un carnet de notes qui n'a jamais été retrouvé, on ne peut tenir compte d'un témoignage isolé insuffisamment étayé de preuves.
Ces sentiments, en tout cas, n'étaient pas ceux du major von Kayser. Dans l'après-midi même du 26, il se rendit à Jeandelize, entra à l'église, où M. le Curé soignait des blessés, et lui déclara brusquement : << Si votre population tire sur nos troupes, vous aurez le sort du curé de Jarny, que nous avons fusillé... >> Et comme M. l'abbé Peyen, d'abord interloqué, objecte ensuite que le curé, mobilisé, n'était plus à Jarny et ne pouvait y avoir un remplaçant, la brute réplique: << Peu importe! C'est pour l'exemple! (1) >>
L'aveu est formel. Le Boche voulait terroriser la région.
(1) Quelques mois plus tard, la "brute" se vantait encore d'avoir commandé cette exécution et celle de M. l'abbé Tamias, curé de Vandières, originaire de Jarny. Est-il besoin de remarquer que l'abbé Mamias était aussi innocent que l'abbé Vouaux et les neuf autres prêtres du diocèse de Nancy fusillés par les Allemands en 1914?
LE 27 ET 28 AOUT
Il n'y a pas à s'étonner que malgré quelques blâmes individuels, une nouvelle cruauté ait été ajouté aux précédentes. Il fut interdit aux parents des victimes de les relever et de leur donner la sépulture. Ce fut même seulement au matin du 27 que la famille du maire, entre autres, apprit la fin douloureuse et glorieuse de son chef.
Ainsi pendant deux jours, et pour quelques uns deux jours et demi, vingt cinq corps restèrent étendus dans les rues et chemins : les troupes les bafouaient, les rares passants civils pleuraient.
Celui de l'abbé surtout provoquait ces hommages et ces insultes. Cependant toute pitié n'était pas absente du cœur de certains ennemis. De loin, Mme Mangin A. vit un officier saluer les otages, un autre repousser violemment un soudard qui soulevait la soutane du prêtre. Mais les poches avaient déjà été ou furent ensuite fouillées; car le 28 on y trouve, à la place d'un porte-monnaie dont le contenu était assez important, une pochetavec un mark et quelques pfennigs.
Un troisième officier s'était montré encore plus délicat. Il recueillit le pince-nez de l'abbé et enleva le chapelet des ses doigts avec l'intention de rendre à la famille des objets si précieux par le souvenir. C'est du moins la déclaration qu'il fit plus tard à l'abbé Bruneau, prisonnier, la dernière année de guerre, non loin des frontières de Suisse. Il demandait l'adresse de la famille du curé de Jarny : on lui conseilla de s'adresser à l'évêché de Nancy dès que ce serait possible. Malheureusement, ni l'évêché ni la famille n'ont jamais rien reçu.
Un soldat, dans un but moins louable, avait pris une petite croix et des papiers. Blessé ou malade, soigné dans un village près de Metz et poussé par le remords, il promit de restituer le tout. Seule la petite croix est revenu à Jarny.
<<L'exemple>> s'était prolongé. La chaleur d'août allait amener la décomposition. Voilant sa pitié sous des raisons d'hygiène publique, le Dr Bastien réclama l'inhumation des victimes. D'autre part, un officier allemand aurait insisté en ce sens auprès du commandant d'étape. Bref, la permission d'enterrer fut changée en ordre.
Sous la direction de M. Grimard, des équipes de jeunes gens furent constituées, une voiture réquisitionnée. Durant la matinée du 28, au milieu des ruines fumantes de vingt à trente immeubles, la lugubre corvée parcourut les rues où n'apparaissaient que des soldats, les habitants restant prostrés dans les maisons épargnées, et à travers champ conduisit au cimetière la charge lamentable. Là, une autre équipe d'hommes creuse à la hâte des fosses communes, où, côte à côte, seront étendus les malheureux.
Entre temps, l’autorisation, obtenue on ne sait par qui, parvint <<de mettre dans un cercueil le maire et le curé>>. Mais la piété familiale ou paroissiale, surmontant toute crainte, l'avait devancée. Pour deux autres victimes au moins, on assemblait déjà rapidement les planches qui contiendraient leurs restes dans une tombe particulière.
En attendant que tout fût prêt, les corps étaient déposés à l'abri de quelques arbustes.
Et voici qu'enfin la prière officielle de l’Église catholique peut s'ajouter aux supplications éperdues des familles jarnisiennes!
Un prêtre sarrois, aumônier militaire, M. l'abbé S...., chargé de visiter les champs de bataille de la région, apprend ce qui s'est passé; par Doncourt il arrive à Jarny, et, guidé par des personnes de la localité, se rend au cimetière. Il y aperçoit (1) << les masses de chaire criblées de balles. Cependant la tête de M. le Curé était intacte, par conséquent parfaitement conservée. A la vue de ces innocentes victimes j'ai pleuré bien amèrement et tout le monde avec moi. Le brave chantre de Jarny était inconsolable...>>
(1) Ce sont les termes même de sa déposition qui sont ici traduits
L'aumônier pria longuement pour tous. Puis il demanda quelques renseignements au docteur, à qui il parut sincèrement affligé de la conduite barbare de cette guerre. Il fit enfin chercher dans les poches de la soutane, mais en vain, la clef du tabernacle, car il voulait sauver les Saintes Espèces, et revint au village. Citons encore sa lettre.
<< Indigné de voir ainsi maltraitées des personnes qui n'avaient rien à se reprocher, je suis allé trouver le général qui avait prononcé la sentence de mort et fait exécuter tout de suite. Je lui ai demandé pourquoi on traite ainsi des gens absolument innocents. Pour toute réponse il me dit : << Ce curé n'avait qu'à discipliner ses gens, qui ont tiré du clocher de l'église pour donner l'alarme. D'ailleurs il fallait cet exemple pour empêcher les autres de les suivre. >> J'ai reconnu à cette parole que lui, général, était seul responsable de cet acte barbare.
<< J'ai aussi remarqué dans la foule un officier à qui j'ai reproché sa dureté et son manque de cœur : autrement il aurait fait appeler l'aumônier pour entendre à confesse et absoudre ses pauvres victimes condamnées si injustement. << A présent je fais mon meâ culpâ. Je n'ai pas songé à cela >>, m'a-t-il répondu...>>
Laissons à chacun sa responsabilité : le Souverain Juge ne s'y trompera pas!
... Cependant, le cercueil est arrivé, la fosse est prête, bientôt le corps de l'abbé Léon Vouaux repose dans le sol de cette paroisse pour laquelle, prêtre du Christ, il a tout sacrifié, d'où son âme s'est élevée jusqu'à l’Éternelle Patrie.
Pour venir à Jarny, M. le curé de Labry n'obtint un laissez-passer que le 4 septembre. A cette date encore, il le constate: << Le pauvre village était encore terrorisé, la douleur publique navrante. Tous pleuraient les morts de la grande famille; mais plus que tous les autres fut pleuré le bon Abbé, dont les paroissiens avaient senti la profonde affection et le dévouement sans borne.>>
Au lieu de l'exécution un modeste monument érigé par les familles, sur la tombe une simple croix indiquent les deux dernières étapes terrestres de l'abbé Léon Vouaux. A l'église, vers le 26 août de chaque année, la paroisse entière prie avec recueillement pour toutes les innocentes victimes des Allemands à Jarny.
Le nom de l'abbé Léon Vouaux se retrouve sur la plaque d'une des rues de Jarny, sur les murs du Panthéon, à Paris parmi les << écrivains morts au champ d'honneur >>, sur la liste des chevaliers de la Légion d'honneur.
TABLE DES MATIERES
Au très cher abbé Léon Vouaux
Une victime des Allemands, à Jarny
AU TEMPS DE PAIX
La vie
Les œuvres
LES SEMAINES DE GUERRE
L'Acceptation du Sacrifice
L'Attente du Sacrifice
La Consommation du Sacrifice
Imprimerie AUBANEL
FRERES AVIGNON
LES ACTES DE PAUL ET SES LETTRES APOCRYTHES,
Titre : Les actes de Paul et ses lettres apocryphes / introd., textes, trad. et commentaire par Léon Vouaux,...
Éditeur : Letouzey et Ané (Paris) Date d'édition : 1913 Contributeur : Vouaux, Léon. Éditeur scientifique
Type : monographie imprimée Langue : Français Format : 1 vol. (VII-384 p.) ; 20 cm Format : application/pdf
Droits : domaine public Identifiant : Source : Bibliothèque nationale de France
Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35402750q
Description : [Bible. N.T.. Apocryphes. Actes de Paul (hébreu-français). 1913]
Description : Collection : Documents pour servir à l'étude des origines chrétiennes
Provenance : bnf.fr Date de mise en ligne : 05/01/2015
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 08/10/2017



 ème visiteur
ème visiteur